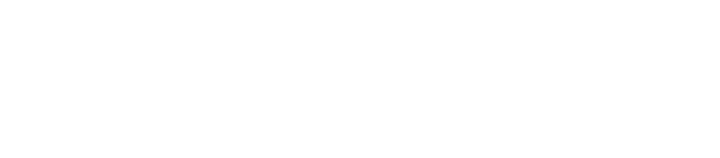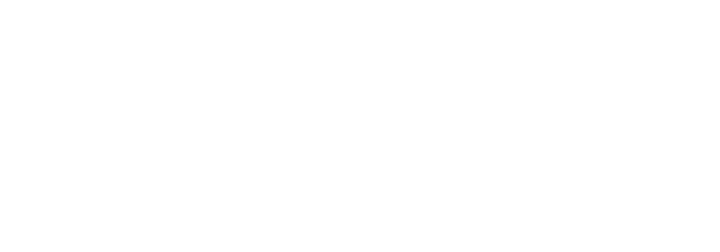FuturHebdo part à la découverte du messie de la prospective dans le grand effondrement du monde qui se fissure – de ce présent qui nous nargue. Luc Dellisse débarque avec armes et bagages… Aventure, Longue Portée…
Aventure est son manifeste. Notez, lecteur, qu’il ne dit pas que l’éthique sera une dystopie. Il est trop bien élevé. Son utopie vaut son pesant d’ironie.
Longue portée sera la Winchester de la conquête du futur. Au-delà de l’Ouest et de ses mythologies de cow-boy, l’homme sera intranquille, à jamais chasseur-chassé en habit de ville. On dira drôné pour qualifier cette traque.
Dans les textes de Luc Dellisse que vous allez découvrir, lecteurs avisés, un secret mal gardé – sinon serait-ce un secret ? – sous forme de geyser brûlant… de vent solaire… qu’il nomme littérature et qui est son feu central – ici le mot feu est la métonymie qu’emploie le combattant qui fait feu pour dire qu’il déclenche ses tirs.
Ne vous attendez pas à une prospective spectaculaire de type space opera. Luc Dellisse est un collapsologue souriant, un brin narquois, pas dupe, mais déterminé.
Il est romancier, professeur de scenario et poète. Il explore dans ses romans ses passés, qu’il réinvente par l’écriture, leur faisant opérer une mutation qui fait du temps un éternel présent. Ses explorations du visible/invisible sont des phares dans la nuit du mythographe. Son 2013 Année Terminus relevait en 2012 d’une étonnante expérience : un texte vibrant, impertinent, désespéré et pourtant espérant. Il annonce sans vergogne un futur immédiat calamiteux. Il ne s’agissait pas de croire ou ne pas croire à ce qu’écrivait l’auteur, il s’agissait d’éprouver ce que pourraient être les répliques d’un tremblement de terre venu du futur. C’était un livre sur les vibrations prophétiques, persifleur un peu, drôle beaucoup, désespéré donc, mais est-ce le problème ? Le livre vibrait comme l’immeuble que secoue le tremblement de terre, le livre tremblait de la colère de l’auteur qui fustige la bêtise des hommes qui ont permis (ne serait-ce que pensé) qu’un tel futur advienne. Une littérature de guérilla d’un humour incandescent.
Même ses livres sans rapport immédiat avec l’avenir, comme récemment L’amour et puis rien (octobre 2017), décrivent en filigrane un monde d’après la Chute, un monde d’apocalypse ordinaire, où tout, absolument tout, est à réinventer.
Christian Gatard
—•—
Fermeture stellaire
A l’extrême fin de cette année de glace, je suis en train d’achever mon nouveau livre. Il s’appellera les Étoiles fermées. C’est une suite de sept nouvelles, organisées en roman. L’histoire se déroule entre 2011 et aujourd’hui, mais elle est mue par une petite pile électrique située dans le passé : en 1979.
Cette année-là, au début de l’été, six étudiants pauvres qui ne se sont pas quittés durant toutes leurs études fêtent leur diplôme, avant de partir chacun vers sa destinée. L’un d’eux est obsédé par la modernité qui vient : les premiers vols habités sur la lune lui font prévoir un monde où l’on circulera à travers le système solaire comme on franchit les continents, et où le travail humain ne sera plus qu’un long loisir. Selon lui, l’homo spatialis est né, et ils en sont les premiers représentants. Il faudra trente-cinq ans tout au plus pour conquérir Mars et Titan, y construire des villes et y organiser la circulation du temps. Les autres se laissent porter par son enthousiasme, par le désir de se revoir quoi qu’il arrive, et par quelques complicités amoureuses qui les lient en secret. Ils prennent rendez-vous pour le 1er janvier 2014, dans la petite ville où tout a commencé.
Le narrateur, après un parcours fait d’amours, d’aventures et d’un secret toujours actif, se rend à ce rendez-vous presque oublié. Rien ne ressemble moins à une civilisation de l’espace que le long trajet à bord de trains d’utilité locale de plus en plus antiques et de plus en plus lents. Il débarque, non dans un univers de science-fiction, mais dans une sorte de XIXe siècle préservé du temps. Personne ne l’y attend, en apparence. Il est vrai que celui qui avait fixé ce rendez-vous dans le siècle des voyages interstellaires est mort, d’un long cancer, aux soins palliatifs, à New York : le seul sans doute à avoir trouvé le chemin des étoiles. Pour les autres, présents ou absents, la route est fermée, et l’univers virtuel contigu au nôtre est immobile comme un film mis sur pause.
Mais le narrateur n’est pas vraiment le seul à être venu au rendez-vous, et l’histoire ne s’est pas arrêtée un instant pendant qu’il croyait être le seul à vivre un roman. Le secret enfoui ressort, et l’aventure se déclenche, sur un rythme accéléré. Venise, Berlin, New York, Bruxelles, Istamboul sont les principales pièces du puzzle à reconstituer.
Écrire est pour moi un va-et-vient entre le sentiment le plus aigu de ma vie actuelle et la mémoire vivante de principaux épisodes de ma vie. Ce livre en cours me permet d’adosser mon désir d’avenir et d’espace au spectacle mythologique qui a fécondé mon adolescence : la conquête spatiale.
—•—
Aventure
L’histoire est barbare par essence. Nous avons pu l’oublier, dans nos pays d’Occident, mais il suffisait de regarder les écrans dont on nous entoure, comme d’un capitonnage d’informations rituelles, pour être éclairés. Il suffisait même de prendre le métro : la brutalité, la pauvreté, l’incompréhension, circulent en flux tendu, presque sans répit. Impossible, les yeux ouverts, de croire que le monde, procédant par essais et par erreurs, va de mieux en mieux.
Nous avons vécu dans une réserve d’espèces protégées, et ses hautes barrières ne servaient pas à nous préserver de l’extérieur, mais à nous empêcher de le voir. Elles sont tombées, et nous voyons que la guerre règne, et qu’elle n’est pas un moment du désordre du monde, mais son cours ordinaire, son seul équilibre. La violence des rapports humains peut être considérée comme la vérité des rapports humains. Ainsi, les avatars du terrorisme, son imminence quotidienne et ses surgissements aléatoires forment la signature parfaitement lisible d’un pacte avec la mort.
2018. Il faut à nouveau envisager comme possible d’être tué, avec les siens, avec ses proches, par des adorateurs de Baal-Moloch. Il faut se poser du même coup, en contre-point, la question de tuer et de savoir comment tuer, chose qui semblait réservée aux périodes sombres et aux mœurs sauvages de nos ancêtres. La sérénité, quand on a le poids d’une arme absente dans sa poche, prend soudain une couleur spéciale.
2018. Une aventure commence, celle du désir de création dans un univers de destruction. C’est précisément ce déséquilibre qui rend à la fois possible, fragile et désirable la civilisation au XXIe siècle.
La civilisation, ce n’est pas l’activité des hommes, encore moins leur progrès. C’est l’effort intermittent et souvent contradictoire pour dépasser la répétition. On en trouve un peu partout les traces et les promesses. On n’a pas de preuves qu’elle a jamais été un état de fait, ni même un idéal. La civilisation n’est pas un fait, mais une éthique : c’est-à-dire une utopie.
—•—
Longue portée
Que les drones existent et se multiplient, nous le savons bien.
Il est inutile de rappeler que l’espace des villes et des terres habitées est sillonné désormais par de petits appareils de surveillance qui nous suivent de loin et portent leur regard dans le champ clos de nos maisons et de nos vies.
Mais leur version militaire est en train de transformer la chevalerie brutale de la guerre aérienne en jeu vidéo géant.
Ces faux boomerangs qui traversent le ciel aveugle pratiquent la guerre d’une manière nouvelle : de loin, sans personne à bord pour en prendre le risque ni en payer le prix. Puis, ayant atteint leur cible, ils s’arrachent à la menace, et repartent vers leur base connectée.
La peur, l’avarie, le cockpit qui saute, le pilote qui s’éjecte, le beau flocon blanc de son parachute qui se balance sous la queue de fumée noire : une vieille saga mythologique en train de s’effacer.
Les rapides oiseaux glacés qui ont succédé aux chasseurs aériens sont dirigés à distance, dans des bureaux blindés, et leurs yeux caméras tiennent lieu de cockpit grand angle, pour offrir au pilote, à six mille kilomètres de là, un champ de vision plus clair et plus net.
Les combattants nouveaux ne sont pas de solides gaillards rompus à supporter la force centrifuge, les embardées, les trous d’air, les reprises fulgurantes, les renversements du ciel, les rafales, le destin rapide sous le feu d’en face, l’éjection ultime, la chute lente au-dessus d’une jungle pleine de piège, d’une mer pleine de requins. Ce ne sont pas forcément des sportifs, et pas du tout des baroudeurs mais des experts de l’index, des aventuriers de l’œil.
Ils portent une veste de ville, une chemise ou un uniforme, ils boivent du café en face de la cible et ont une obligation de résultat. Leur chef de service, ou leur supérieur s’ils sont militaires, se tient derrière eux. Leurs missions sont précises et sans ambiguïté. La surveillance y joue un moindre rôle que l’attaque et la destruction. Les dommages collatéraux sont fixés préalablement.
Leurs réflexes et leur habileté n’ont rien d’imaginaire. Leur esprit de décision doit être à toute épreuve.
Pour les générations nouvelles qui ont passé leur enfance et leur adolescence penchés sur leurs consoles et leurs écrans de prouesses guerrières, ces opérations sont un simple prolongement de leurs jeux en réseau, et leur brio, celui d’un joueur surentraîné.
Les jouets qu’ils manipulent sont des géants numérisés pour figurer leurs doubles miniatures. Mais c’est en taille réelle qu’ils frappent vite et fort.
Libéré de la pesanteur terrestre, l’esprit survole enfin la carte de géographie du monde zéro mort. Un déclic et c’est l’effet Google Maps, les lettres, les mots, les couleurs, les indications pointillées, disparaissent et les reliefs du monde véritable surgissent en rase-mottes : la cible va bientôt surgir.
En 2016, les États-Unis ont lancé 473 opérations mortelles – dont la plupart ont été effectuées par des drones – ce qui a entraîné la mort de 2372 à 2581 combattants et de 64 à 116 civils. Ces chiffres étant fournis par les États-Unis, on ignore évidemment combien de vivants supposés, de non-morts officiels, ont rejoint leurs ancêtres dans l’opération.
Avions robots, armés comme des frégates, puissance de feu de la mort cinéma.
Ils font leur œuvre lointaine dans une immédiateté parfaite.
Ils glissent sur le monde en flammes puis remontent, par cercles toujours plus larges, jusqu’au ciel bleu.
—•—
Une vie dans ma vie
J’écris depuis l’adolescence. Mais l’idée de m’interroger sur le sens de cette activité bizarre ne m’est venue que récemment.
Voilà deux ou trois ans à peine que je consacre l’essentiel de mes recherches à comprendre les ressorts de l’aventure la plus obstinée et la plus durable de mon existence : la littérature. Je suis, pour le meilleur et pour le pire, quelqu’un qui depuis l’âge de 13 ou 14 ans a toujours essayé de faire entrer le monde qu’il percevait dans une trame textuelle continue – non pas simplement l’écriture, mais la pensée tout entière.
Je n’ai jamais agi, aimé, voyagé, respiré, que dans le souffle d’une phrase sans fin, dont la ponctuation, le rythme, le phrasé m’étaient fournis par les circonstances du voyage. La littérature ne m’apparaît pas comme une musique qui accompagne la vie, mais comme la vie en chair et en os.
Cette détermination initiale, ce pacte sans cesse renouvelé, m’ont fait différent de la plupart des gens, et assez indifférent à cette différence. Je ne m’en suis pas moins demandé, très souvent, si j’étais le seul de ma sorte. J’ai croisé quelques écrivains, quatre ou cinq ; et en plus grand nombre, des auteurs de livres : il ne m’a pas paru qu’ils étaient aussi possédés que moi. Plutôt dirais-je qu’ils exerçaient leur métier, quelquefois très bien. S’ils avaient un secret ils l’ont gardé.
Mes véritables rencontres avec les représentants de la passion d’écrire se sont produites à un autre niveau, celui de la mémoire. Si je veux confronter ma folie à d‘autres folies, si je veux jouir du grand bonheur de ne pas être seul, je ferme les yeux. La vision se décale. L’univers se repeuple. Mais par quel mécanisme, ou par quelle magie ?
Ma découverte que l’avenir avait autant d’impact que le passé sur notre vie présente continue à produire ses effets. La fin de la culture classique, à peu près achevée, crée un appel d’air. J’écris, désormais, mes histoires à venir.
Arc électrique entre deux pôles : de cette flèche rapide naît la connexion. Le principe de cette expérience de physique n’est rien d’’autre que la production d’énergie nécessaire pour mettre en fiction ce qui n’a pas encore de visage, ni même de nom.
© Luc Delisse


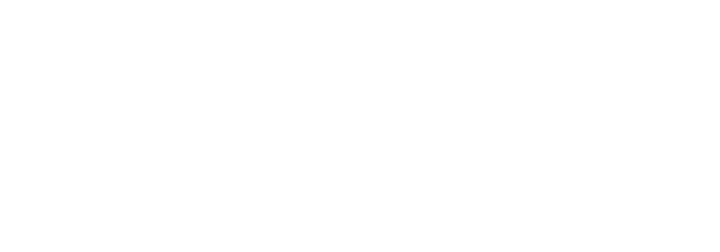
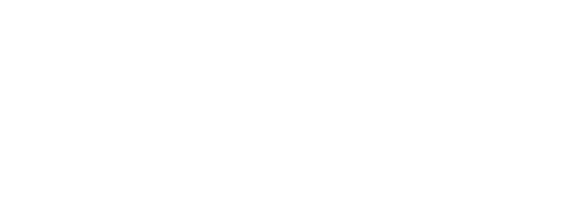

 Ecko Magazine
Ecko Magazine