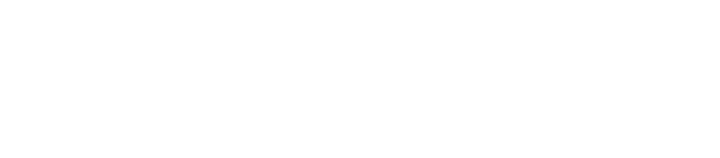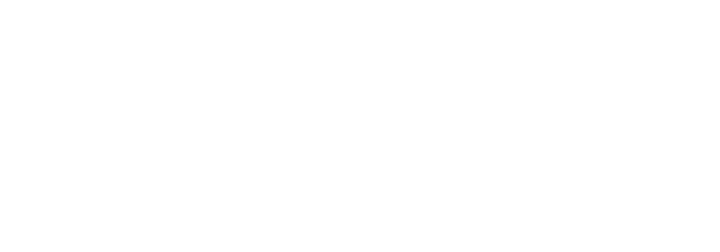Romanciers 3 – Experts 0
Article écrit en 2010
Publié aux États-Unis en 2007, The Reluctant Fundamentalist décrivait la transformation d’un Pakistanais parfaitement intégré aux États-Unis en terroriste. Deux ans plus tard, le commandant Nidal Hassan tuait treize personnes sur une base américaine du Texas et le 1er mai 2010 Faisal Shazhad, un Américano-Pakistanais, tentait de faire exploser une voiture aux abords de Time Square. À l’évidence, le romancier avait anticipé ce que les services spécialisés n’avaient pas vu venir. Pourquoi dans ces conditions, l’anticipation romanesque n’a-t-elle pas sa place dans la prospective sécuritaire ? Trois raisons peuvent expliquer pourquoi les experts institutionnels refusent par corporatisme un concours qu’ils vivent avant tout comme une concurrence.
Le 11 septembre 2001 n’a guère surpris que les prévisionnistes qui n’avaient déjà pas anticipé la chute du Mur de Berlin. En 1998, Maud Tabachnik avait imaginé dans Les Cercles de l’Enfer, un milliardaire islamiste agrégeant autour de lui les réseaux terroristes du monde entier pour porter le fer au sein des démocraties laïques et décadentes. Deux années plus tôt, Tom Clancy avait anticipé dans l’un de ses thrillers vendus en millions d’exemplaires (Sur Ordre) l’action d’un kamikaze japonais précipitant un Boeing 747 sur le Capitole. Dans un autre registre, Dominique Lapierre et Larry Collins avaient décrit dans Le Cinquième Cavalier les procédés utilisés par un État proliférant pour déjouer les contrôles de l’International Atomic Energy Agency (AIEA) avec une telle précision que ce roman sembla anticiper le rapport de la commission Ekens qui enquêta en Irak.
De Jules Verne à Hergé, la liste des auteurs ayant prévu le devenir du monde est donc longue. Des romans que les esprits critiques qualifient volontiers d’ouvrages de gare ont ainsi été capables d’annoncer ce qu’experts, analystes et autres futurologues officiels n’avaient jamais imaginé. Pourtant, les moyens investis dans la prospective sécuritaire sont loin d’être négligeables. Du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDNS) à la Délégation aux affaires stratégiques (DAS) en passant par la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) et la direction centrale du Renseignement intérieur (DCRI), sans négliger les incessants colloques académiques destinés à anticiper les guerres de demain et les publications plus ou moins savantes décryptant les nébuleuses terroristes, l’énergie dépensée est à la hauteur des craintes que suscite la capilarisation des risques inhérente à la sécurité globale.
Pourquoi, dans ces conditions, des romanciers ayant démontré leurs capacités à prédire avec précision un avenir plus ou moins lointain n’ont-ils pas leur place dans les cénacles de la prévision ? De manière plus générale, pourquoi une méthode d’anticipation ayant fait ses preuves ne bénéficie-t-elle pas d’une reconnaissance à la hauteur de ses résultats ? Trois explications peuvent être invoquées pour expliquer cette surprenante absence de crédibilité.
Les mages de l’Apocalypse
La première de ces raisons est liée à la multiplicité des romans et des scénarios anticipant en détail l’Apocalypse prochaine. Les thèses millénaristes ou les prophéties de l’Armageddon exercent un attrait irrésistible auprès d’auteurs ou de réalisateurs persuadés de détenir la clé du succès avec l’annonce de lendemains sans surlendemains. Les effets spéciaux remplacent alors la pauvreté du scénario décrivant comment la terre cessera de tourner sur elle-même le 21 décembre 2012, le rythme de l’action pouvant, dans le meilleur des cas, faire oublier les invraisemblances du scénario (Die Hard 4). Quelques écrivains ou scénaristes ont certes vu juste, mais la liste de ceux qui se sont contentés de décrire leurs fantasmes est infiniment plus longue. Par souci de répondre aux attentes du public qui aime à se faire peur ou par besoin de crier au complot, la très grande majorité des auteurs déborde d’imagination complaisante pour projeter leurs lecteurs dans une spirale délirante de catastrophes d’autant plus palpitantes qu’elles formalisent des menaces plausibles.
Dans ce registre, les créateurs en manque d’imagination ont l’embarras du choix. La perspective d’un attentat nucléaire est bien sûr en haut du palmarès. Il faut cependant être en panne d’inspiration pour proposer un tel manuscrit qui aura peu de chances de séduire un éditeur, même si Barak Obama vient de réhabiliter l’hypothèse en réunissant en avril dernier son sommet contre le terrorisme nucléaire. Si l’atome, comme le bactériologique, demeure encore aujourd’hui hors de portée de la majorité des réseaux terroristes (à la fois pour des raisons financières et d’ordre technique), l’extrémiste moins exigeant pourra toujours avoir recours au chimique pour contaminer les réservoirs d’eau potable des grandes métropoles ou les systèmes de ventilation des buildings de la Défense. L’explosif n’a pas perdu pour autant tout crédit et a même trouvé un nouveau souffle avec les kamikazes prêts à se faire exploser dans les transports en commun (à l’heure de pointe), dans les gares ou les aéroports, ou encore dans les stades (le jour de finale du Super Bowl ou de la Coupe du Monde de préférence). Si possible, un comparse légèrement blessé lors du premier attentat se fera exploser quinze minutes plus tard pour désorganiser les secours et envoyer ad patres le maximum d’officiels. Comme les extraterrestres qui privilégient le territoire des États-Unis pour envahir la terre, nos candidats au martyre sont immanquablement attirés par les lumières des grandes villes occidentales, New York, Londres et Washington constituant leurs destinations favorites.
Les mobiles évoluent dans le temps, mais ne sont un mystère pour personne. La lutte des classes et la solidarité tiers-mondiste ont eu leurs heures de gloire avec Carlos. Elles sont désormais démodées et ont été remplacées par le radicalisme islamiste. Plus original, le nihilisme anticapitaliste est également plus sophistiqué. Les infrastructures critiques constituent sa cible privilégiée. Internet est bien sûr le vecteur de son attaque qui sera déclenchée par un programme malveillant ou un virus informatique qui désorganisera en quelques heures la finance mondiale. Enfin, au dernier degré de la complexité, le terroriste mafieux, qui dissimulera son projet crapuleux derrière ses revendications politiques, utilisera une combinaison de moyens classiques et informatiques. L’explosion d’une bombe électromagnétique lui permettra de s’introduire au cœur du système ennemi ou un programme particulièrement pervers lui permettra de vider les comptes de tous les patrons du CAC 40 et/ou de toutes les personnalités politiques. Robin des Bois est une valeur sûre pour séduire le public et s’il reverse une infime partie de ses rapines à une ONG, notre escroc sympathique – auquel Georges Clooney ne manquera pas de prêter ses traits lors de l’adaptation cinématographique de ce succès d’édition – sera assuré de la plus totale impunité.
Ces trames convenues et trop linéaires ne présentent pas, à l’évidence, un grand intérêt opérationnel et leurs capacités d’anticipation sont à peu près nulles. À moins de placer l’armée et la police en alerte 365 jours par an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il apparaît difficile d’accorder à ces scénarios plausibles, mais imprécis la moindre utilité pour la prospective sécuritaire. Malgré tout, ces fictions pourraient être mieux utilisées pour la communication des services de sécurité. Ne pouvant mal finir, elles donnent en effet une dimension épique au patient travail d’enquête qui transforme la catastrophe annoncée en non-événement (l’attentat qui n’a pas lieu). À côté du Prix du Quai des Orfèvres qui fleure bon son Maigret d’antan, il conviendrait donc d’organiser un prix du thriller que les membres du comité de rédaction des Cahiers de la Sécurité pourraient attribuer tous les ans après un déjeuner au Jules Verne.
Modernité et Raison
La deuxième raison qui explique le désintérêt pour l’intuition romanesque est plus fondamentale et trouve ses racines dans la modernité. Jusqu’à la Renaissance, la narration était l’une des clés de la connaissance. Les récits obéissaient à une logique cyclique montant graduellement jusqu’au paroxysme quand un événement fortuit entrait en résonance avec les passions chauffées à blanc. Les œuvres de l’époque se terminaient rarement sur une note optimiste et les survivants se réveillaient épuisés au milieu des cendres de leurs cités, étonnés d’être encore vivants. « Comment cela s’appelle-t-il quand le jour s’élève dans le froid, que tout paraît gâché, saccagé, mais que pourtant l’air se respire ? » (Jean Giraudoux – Electre). L’Histoire était alors tragique et les Grands de ce monde ne se cachaient pas pour consulter mages et devins qui leur révélaient les intentions des dieux inscrites dans les étoiles. La modernité s’est chargée de tuer le tragique en misant sur la seule Raison. Le chaos étant un ordre que l’on avait su voir, l’esprit se chargeait de donner sens au monde. Du Big Bang à la théorie du signal, les sciences dures ont ainsi tenté de mettre au pas la nature en expliquant les catastrophes d’hier pour parer celles de demain. Mis en équation, le hasard est devenu nécessité et la physique fondamentale a transformé les turbulences sur les ailes d’avion ou les vibrations dans les boîtes de vitesse en paramètres chiffrés. Convaincus que les mêmes causes dérivent des mêmes effets, philosophes idéalistes et réalistes se sont accordés sur l’idée de la confusion naturelle d’une « diversité sensible » que l’entendement organiserait en énonçant les « lois objectives » du devenir du monde. Le désordre était alors une défaite de l’intelligence, « une déception de l’esprit » selon Bergson qui préférait le considérer comme « un ordre que nous ne cherchons pas ». Science et philosophie ont ainsi pris la mesure du monde réel que l’Homme est – à peu près – parvenu à comprendre et à expliquer. Cependant, les passions humaines ont résisté à cette inquisition scientifique. Si l’on connaît l’action de l’épinephrine ou de la norépinephrine sur les marqueurs du nerf vague qui, en douze millièmes de seconde, activent l’intelligence émotionnelle, aucun système rationnel ne peut encore prévoir le passage à l’acte. En d’autres termes, aucune science, aucun schéma logique ne permettent encore d’associer des prémices identifiables à une action prévisible de l’individu ou des foules.
Comme l’écrivait l’historien Donald Kagan à propos des guerres, celles-ci surviennent « là où on ne l’a pas imaginé, pour des raisons qui n’ont souvent pas été identifiées ». Le paradoxe consiste alors à vouloir anticiper l’avenir avec les seuls outils de la Raison et à n’accorder aucun crédit à des formes de savoir utilisant l’intuition et l’expérience, l’imagination et la perception. La solution consisterait dès lors à combiner les grilles d’analyse en renonçant, comme le recommandait Bergson, au tout inductif. En partant de l’expérience acquise, l’induction permet en effet de réduire les risques de voir se reproduire les mêmes événements. Après le 11 septembre, tous les attentats visant des avions ont ainsi été évités et la liste des tentatives déjouées est incontestablement plus longue que la liste des attentats réussis. Inversement, l’ensemble des mesures prises n’évitera pas la prochaine offensive majeure. La mobilisation des services de sécurité du monde entier réduit à l’évidence la marge de manœuvre des apprentis terroristes qui, pour réussir, devront exploiter les failles des dispositifs déjà déployés. À côté du recueil des informations, c’est leur imagination qui est avant tout mobilisée dans cette préparation et seul leur « génie inventif » leur permettra de réitérer leurs exploits.
De ce fait, la solution consisterait à mobiliser la même imagination en recrutant quelques auteurs particulièrement inventifs. En leur garantissant l’accès à toutes les informations classifiées dont ils pourraient avoir besoin, ces auteurs bénéficieraient d’un temps d’avance sur les terroristes qui peinent à réunir ces données très protégées. Comme la liste des failles est malgré tout réduite, une équipe restreinte suffirait à combler les brèches, sans bien sûr garantir une sécurité absolue. Les ouvrages seraient écrits à la première personne du singulier, les auteurs se plaçant dans la peau des terroristes, et devraient s’achever sur une gigantesque explosion sans intervention providentielle de Bruce Willis sauvant in extremis l’Humanité pour la nième fois. Bien sûr, ces fictions n’auraient pas vocation à être publiées (ce qui justifierait une juste récompense à proportion du renoncement à l’ambition légitime de tout écrivain) et un nouvel Enfer sous haute protection devra accueillir ces œuvres vouées à l’oubli.
Les pièges de la Méthode
Enfin, une dernière raison expliquant le désintérêt pour l’imagination des romanciers est plus intimement liée à la culture française toujours sous l’influence du Discours de la Méthode. Les lois mathématiques expliquant l’univers partent ainsi d’un postulat indémontrable – par définition – qui débouche sur des lois générales à l’issue d’une succession d’assertions logiques. Transposée aux domaines sociaux, cette démarche inductive aboutit à démontrer ses conclusions anticipées dans un plan synthétique qui privilégie toujours l’élégance de la démonstration à la pertinence du raisonnement. Ainsi formatée pour les concours, l’intelligence en France n’a que faire de l’esprit analytique propre à la recherche et ignore l’inventivité indispensable à la démarche hypothético-déductive, quand il s’agit d’imaginer une expérimentation susceptible de confirmer ou d’infirmer une hypothèse. Si les sciences dures échappent à ce rejet de la démarche scientifique du fait des passerelles existant entre les écoles d’application et la recherche fondamentale, il n’en est pas de même pour les sciences humaines et sociales où ces passerelles n’ont pas été établies. Le fossé existant entre l’administration recrutée par concours et la recherche académique n’a, de ce fait, jamais été comblé. Bien plus « l’intellectuel » français sert d’alibi culturel à des élites politico-administratives qui se sentent d’autant plus de connivence avec des esprits brillants capables de sauter de Freud à la géographie des réseaux, que ces mêmes élites sont tentées par les démons de l’écriture. Alors que la pression économique tend à accélérer, pour les sciences dures, le passage de la recherche fondamentale à la recherche de développement, l’utilisation des acquis de la recherche en sciences sociales et humaines demeure très aléatoire. Il avait fallu attendre vingt-huit ans pour que le concept de sécurité globale soit validé par les rédacteurs du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qui n’avaient pas cru bon de l’utiliser en 1994 (alors que le concept était apparu en 1982) 1; il faudra sans doute attendre encore de longues années avant que la perception et l’intersubjectivité ne deviennent parties prenantes à la démarche sécuritaire officielle.
Ces deux instruments forment pourtant aujourd’hui le mainstream des études académiques en matière de sécurité en réunissant les réalistes néo-classiques et les constructivistes « dominants » qui étudient les objets classiques de la sécurité (l’État, les communautés de sécurité, les identités) à travers le prisme de l’idée d’un monde socialement construit par nos représentations et nos valeurs. Cette unanimité pour aborder les questions sociales, et de sécurité en particulier, s’inscrit dans une postmodernité déjà ancienne qui récuse la modernité d’une Raison dominatrice. Les instruments pour appréhender une réalité qui diffère en fonction des valeurs culturelles échappent donc à la grille simpliste d’une causalité univoque et imposent d’imaginer le monde avant d’avoir prise sur lui. Dès lors, la recherche fondamentale a plus d’affinités avec les hypothèses romanesques qu’avec les anticipations sécuritaires officielles qui reflètent prioritairement les fantasmes et les intérêts des élites classiques.
Dresser la cartographie des futures menaces ne doit donc pas être confondu avec la nécessité de combler les failles anciennes de nos dispositifs de sécurité. L’exercice impose de mettre à jour nos vulnérabilités nouvelles et d’anticiper les brèches par lesquelles s’engouffreront les assaillants de demain. L’effort intellectuel est à la mesure de l’enjeu et se déroule en deux temps. Identifier et nommer les acteurs susceptibles de pouvoir recourir à la violence contre nos intérêts vitaux constitue la première étape. Il importe, en effet, de distinguer les acteurs dont les intérêts divergent des nôtres et les acteurs susceptibles de privilégier l’affrontement, lesquels sont, heureusement, moins nombreux que les premiers. Violence et conflit obéissent effectivement à des logiques différentes et la décision de déclencher l’épreuve de force s’inscrit dans un registre distinct de la seule compétition des intérêts. La mesure des émotions et des pulsions qui conditionnent le passage à l’acte échappe par définition à la seule rationalité et relève davantage de la psychologie que de la géopolitique. Confondre les deux revient, dès lors, à confondre adversaire et ennemi et à multiplier les alertes, au risque de ne pas être suffisamment vigilant vis-à-vis des individus ou des groupes prêts à passer à l’offensive. En second lieu, il importe de s’interroger sur nos véritables vulnérabilités qui, avec le concept de sécurité globale, se déploient sur de multiples échiquiers. Les menaces les plus dangereuses portent, en effet, sur les faiblesses que nous n’osons pas nous avouer. À ce titre, la France est aujourd’hui plus menacée par les produits dérivés de sa dette que des banquiers inventifs pourraient lancer sur le marché que par une attaque sur ses infrastructures critiques. Le parachute imposé que représente désormais le devoir de précaution est une autre vulnérabilité majeure comme le montre très clairement la fermeture de l’espace européen décrété après l’irruption du volcan islandais Eyjafjöll en avril 2010. En plaçant les autorités publiques dans l’obligation de prendre des mesures impopulaires, antiéconomiques, voire liberticides, le terrorisme de demain n’aura qu’à trouver le champ où donner l’impulsion que la lourde machine administrative se chargera de transformer en contraintes durables.
Déterminer avec précision l’adversaire prêt à porter le fer dans les failles que nous ne considérons pas comme relevant du registre sécuritaire relève donc davantage de l’anticipation romanesque que de la sage rationalité d’experts labélisés. Ceux-ci sont socialement trop bien intégrés pour être encore suffisamment pervers et partager les idées de tueurs déterminés, trop soucieux de leurs intérêts corporatistes pour désigner un adversaire dont leurs services ne seraient pas spécialistes et trop attachés à leur carrière pour faire appel à des concurrents susceptibles de menacer leurs prébendes. Ces prévisionnistes officiels gardent bien évidemment leur utilité pour verrouiller toutes les brèches mises à jour par les attaques d’hier. À l’inverse, certains auteurs de thrillers particulièrement inventifs ont toutes les qualités requises pour se mettre dans la peau des extrémistes qui, demain, décideront de passer à l’acte. Individualistes, ignorant les enjeux de pouvoir bureaucratique, suffisamment indépendants pour accepter l’appellation d’écrivains « populaires », ces auteurs sont capables de mobiliser cette folie créatrice – ou destructrice – dont un Ben Laden a fait incontestablement usage. Les décideurs politiques honoreraient leurs fonctions en ayant l’indépendance d’esprit de recruter ces prévisionnistes plus efficaces que ceux qu’ils trouvent à foison dans leurs administrations.
Jean-Jacques Roche
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)


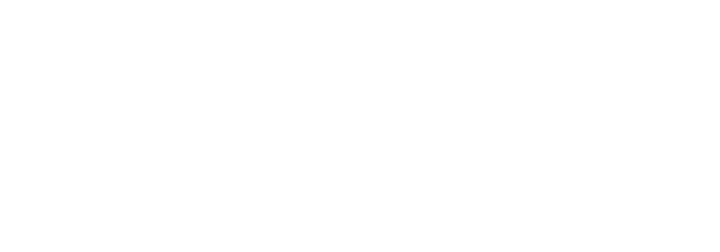
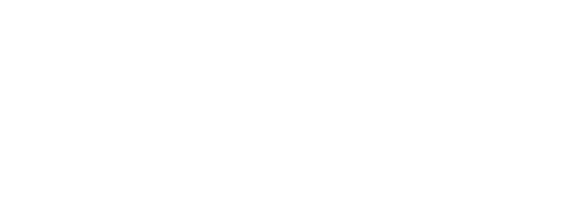

 Ecko Magazine
Ecko Magazine