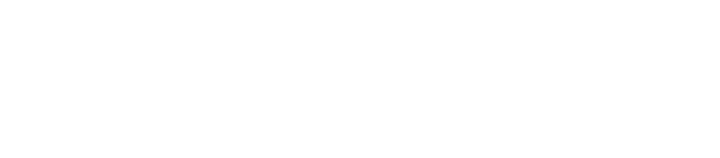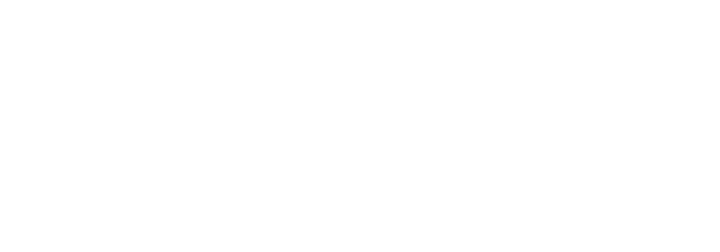« La fin de Babel et autres effets inattendus de la révolution numérique »
Recension mythanalytique1
Jean-Dominique Séval propose une passionnante déambulation prospective. Il utilise tour à tour une loupe pour étudier les balbutiements du présent qui permettent une anticipation de futurs possibles ; puis une longue-vue pour une perspective à moyen terme.
Son regard est fécond. Son angle d’attaque convainquant. Ses paris sur l’avenir sont tout à fait interpellant. Son exploration des conditions anthropologiques de nos évolutions convoque l’histoire, les mythologies, les grands récits et expériences historiques. C’est puissant et réjouissant. On y discerne une vision cyclique , qui n’est pas un enfermement, mais une spirale ascendante portée par une intuition créatrice, instruite, consolidée par l’expérience. Il confirme que nous sommes décidément installés sur les épaules de géants.
La FIN DE BABEL est une vaste exploration de notre début de millénaire, oscillant volontairement entre intuition instruite, prospective du présent, fresque anthropologique et réactivation mythologique. Séval ne s’inscrit pas dans la rigueur méthodologique classique de la recherche académique – et il le revendique d’ailleurs explicitement – mais dans une tradition plus ancienne et plus souterraine : celle des récits de bascule civilisationnelle, où l’avenir se pense à partir des strates profondes de l’expérience humaine, de ses invariants symboliques et de ses récurrences anthropologiques.
Le lecteur est renvoyé à une question fondatrice qui n’est pas technologique mais ontologique : sommes-nous aujourd’hui dans une transition ou dans une rupture ? Et pour quelles expériences, dans quelles situations ? Cette alternative structure tout le propos, non comme un dilemme à trancher, mais comme une tension féconde entre continuité et discontinuité, entre répétition et invention.
N’en a-t-il pas toujours été ainsi ?
D’un point de vue mythanalytique, le texte s’organise autour d’un motif central : celui de parenthèses historiques qui se développent en spirale dans l’histoire du monde. La modernité industrielle, puis numérique, est décrite comme s’inscrivant dans des dynamiques bien plus anciennes : la vie communautaire, la réputation comme capital symbolique, l’oralité, la circularité des ressources, la cohabitation avec l’invisible, la servitude comme moteur économique, ou encore la porosité entre vivants et morts.
Ces parenthèses, ouvertes tantôt au Néolithique, tantôt à la fin du Moyen Âge ou à la Révolution industrielle selon les registres mobilisés, sont-elles en permanence dans un ouvert / fermé, une réitération qui ne serait pas une répétition mais la réinterprétation d’une forme d’injonction vitaliste ? C’est là une piste que ne suit pas Séval – je ne crois pas, en tout cas – mais elle serait un peu dans le Geistzeit actuel et surtout à venir qui se délecte des textes sacrés d’antique mémoire. Séval ne propose pas un récit de progrès linéaire, mais un récit de retour dynamique ( d’où la proposition de l’image de la spirale ), où le futur agit comme un révélateur archéologique du passé.
Cette structure narrative relève pleinement d’un imaginaire cyclique, proche de ce que Mircea Eliade décrivait comme le « mythe de l’éternel retour », débarrassé ici de sa dimension sacrale explicite mais réactivé par la technologie.
La technologie, justement, n’est jamais traitée comme un simple outillage neutre. Elle est investie d’une fonction mythogène : elle réactive des figures anciennes sous des formes nouvelles. Babel réapparaît dans la traduction automatique, Theuth dans l’écriture augmentée et la mémoire externalisée, Héphaïstos dans la robotique, Ogmios dans la reconnaissance vocale, François d’Assise dans l’hypothèse d’un internet inter-espèces, et les fantômes dans les avatars numériques des défunts. Ce recyclage mythologique rencontre nos travaux sur les nouvelles frontières mythologiques. Il suggère que l’innovation n’invente pas ex nihilo, mais qu’elle reconfigure des archétypes persistants.
Cette lecture est particulièrement pertinente pour une prospective qui cherche à dépasser l’illusion de la nouveauté radicale et à identifier les matrices symboliques à l’œuvre dans les transformations contemporaines.
La FIN DE BABEL déploie également une mythologie du savoir et de la transmission. La bascule vers la vidéo, le retour de l’oralité, la disparition relative du texte long, l’avènement d’une pédagogie individualisée sont interprétés comme un retour à des formes prémodernes de circulation des connaissances, amplifiées par le numérique. Nous serions tous des Montaigne portatifs, des Giordano Bruno hypermnésiques, des rhéteurs antiques augmentés par l’algorithme. Cette vision n’est ni naïvement technophile ni franchement dystopique ; elle oscille, assumant l’ambivalence constitutive du mythe.
Cette ambivalence empêche toute lecture morale univoque et maintient ouverte la pluralité des futurs possibles.
Sur le plan socio-économique, la figure du travail occupe une place centrale. Le salariat est décrit comme une anomalie historique récente, une autre parenthèse en voie de clôture, tandis que réapparaissent des formes anciennes de précarité, de dépendance et de servitude. Le « retour de l’esclavage », sous sa forme numérique et machinique, est mis en résonance avec les récits antiques de créatures artificielles et de serviteurs animés. Cette lecture inscrit l’automatisation et l’intelligence artificielle dans une généalogie mythique longue, où la question n’est pas tant la disparition du travail que la redistribution des rapports de domination.
Cette mise en perspective mythologique permet de déplacer utilement le débat contemporain sur l’IA, en le reconnectant à des angoisses anthropologiques fondamentales plutôt qu’à de simples enjeux économiques.
Enfin, Séval explore l’imaginaire politique et spirituel du numérique. D’un côté, la menace d’une hypersurveillance algorithmique, d’une dictature des données et de l’anticipation des désirs ; de l’autre, la promesse d’une démocratie participative renouvelée, d’une agora numérique élargie à l’échelle des nations. Là encore, le mythe structure la pensée : Athènes, Babel, l’Esprit Saint, les fantômes, les oracles. La technologie devient médium entre visible et invisible, entre individus et collectifs, entre vivants et morts.
Cette dimension spirituelle, souvent évacuée des discours prospectifs dominants, confère à ce livre une profondeur singulière et une capacité rare à saisir les transformations du sensible et du symbolique.
Sans remonter à des temps (peut-être) révolus, l’entretien final entre Pascal Picq, Blaise Mao rédacteur en chef de Usbek et Rica et Séval évoque – entre autres échanges passionnants – des figures modernes – Jules Verne, H.G.Wells, Orwell et Isaac Azimov. Ce moment conclusif est particulièrement enthousiasmant : ces auteurs ont pointé vers des scénarios d’avenir . Ils ont compris leur époque, ils ont élaboré des hypothèses. Il importe peu que les mondes qu’ils annoncent adviennent tel quel. Ils ont, comme des Lamarck ou des Darwin en leur temps (évoqués avec gourmandise par Pascal Picq) fait bouger les lignes, bousculé les croyances, fertiliser les imaginaires. Tous un jour ou l’autre finissent par être contestés, recadrés, néotisés2. Les mythes se renouvellent, les mythes s’adaptent.
En conclusion, ce livre, sous ses dehors fragmentaires et parfois foisonnants, propose une véritable mythanalyse du présent. Elle ne cherche pas à prédire, mais à rendre lisible. Elle n’annonce pas un futur, mais révèle des retours, des résonances, des survivances. Sa principale force réside précisément dans cette posture : accepter l’incertitude, penser le futur comme un palimpseste, et assumer que nos avenirs technologiques sont aussi, et peut-être surtout, des affaires de mythes réactivés.
1 La mythanalyse étudie les mythes et les symboles, tels qu’ils se diffusent – encore et toujours – dans nos sociétés contemporaines.
2 Néologisme bien sûr mais s’il y a bien un moment dans l’histoire où on peut se le permettre… Néotiser ne célèbrerait pas naïvement le nouveau, pas plus qu’il ne le condamne frontalement. Il nommerait un rapport spécifique à la nouveauté ; « néotiser » pourrait devenir un terme critique précieux pour penser les économies de l’innovation, les récits de transformation et les subjectivités prises dans un flux continu de renouveau obligatoire… adossé à l’histoire.


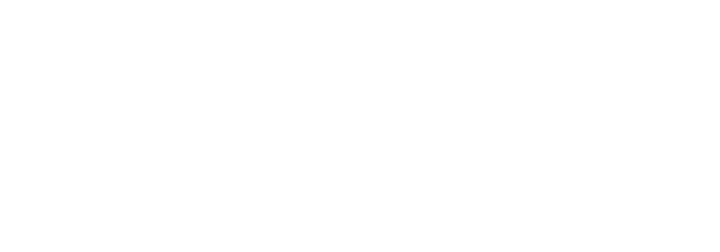
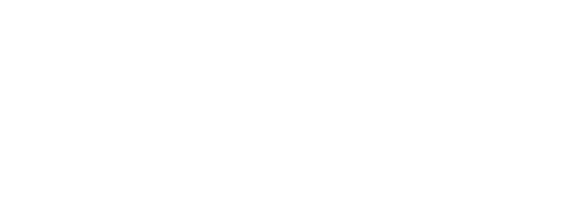

 Ecko Magazine
Ecko Magazine