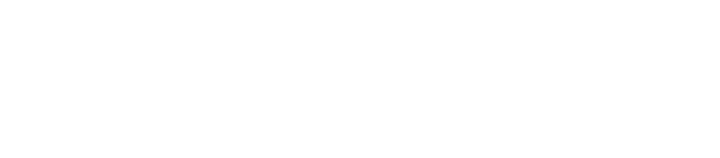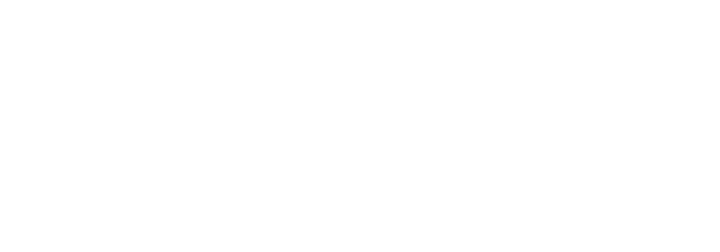Toujours dans le renouvellement de l’exploration du présent, à la lumière d’avenirs multiples, FuturHebdo propose une série d’interviews de personnalités qui, chacune dans leur domaine, sont à la jonction de la société du savoir, de la recherche, et du grand public. Chacune de ses personnalités nous propose sa vision de la place des sciences dans nos sociétés modernes, de la vulgarisation, de la prospective, cette interrogation du présent par le futur…
Tous les interviews seront construits selon la même structure afin de permettre une lecture comparée de ces interviews, entre eux, d’en faire une lecture synoptique.
Aujourd’hui : Riel Miller, Responsable des Laboratoires de Connaissances en Littératie du Futur, à l’UNESCO
Une production Le Comptoir Prospectiviste.fr/Futurhebdo.fr
Olivier Parent (FuturHebdo) : Bonjour, Pouvez vous nous dire où nous sommes et vous présenter en quelques mots ? Quelles sont vos activités dans les domaines des sciences, de la recherche, de l’éducation ?
Riel Miller (UNESCO) : Moi, je m’occupe principalement de fabriquer des processus pour réflechir, pour imaginer l’avenir dans les domaines des sciences, des technologies… mais également dans tout autres domaines tels que le social, la gouvernance… Moi, je suis quelqu’un qui travaille principalement dans le “comment faire, comment penser le futur”. On est à l’UNESCO, au siège de UNESCO. Moi je travaille dans le secteur qui s’appelle sciences humaines et sociales, qui est une des 5 unités — éducation, science, culture et informations — qui sont les 5 secteurs de UNESCO.
OP : A votre sens la relation entre le savoir érudit scientifique et le savoir populaire est elle en train d’évoluer ?
RM : Absolument, je pense qu’on est principalement à un moment dans l‘histoire humaine où notre rapport aux connaissances et au savoir est en train de changer. Côté production et création, et côté utilisation et demandes. Ça veut dire qu’on est en train d’assister à une refondation de notre rapport avec la réalité qui passe à travers nos réflexions et nos connaissances. On est une espèce qui a ce filtre, que sont nos idées, et qui structure notre façon d’être et tout ça pour des raisons scientifiques mais aussi pour des raisons liées à notre capacité d’emmener nos outils, qui sont en symbiose avec les humains depuis toujours, vers une autre plaine d’opportunités…
OP : Quels rôles tiennent les sciences dans la construction permanente, de nos sociétés, de nos esprits ?
RM : C’est intéressant comme question. Moi, je préfère une définition de sciences très générale mais quand même rigoureuse dans la mesure où je considère que la démarche scientifique est principalement une démarche d’interrogation : c’est notre manière d’interroger le monde autour de nous. Dans ce sens, que ce soit un bébé qui interroge son environnement ou un professeur, cette démarche est une chose est universelle. Et quand on est capable de se rendre compte que, comme le font les enfants, d’ailleurs, les expériences nous emmènent vers les échecs… que nos hypothèses sont souvent fausses… que on est en train de découvrir la réalité qui nous entoure, en permanence… dans ce cas-là, le mystère et l’émerveillement sont courants tous les jours, sont quotidiens.
La difficulté c’est qu’on considère la science comme quelque chose de figé, quelque chose qui nous apporte des certitudes et quelque chose de fixe, pour tout le temps. Alors que le rapport au monde, à l’univers, qui est un univers relationnel, n’est pas dans la relation subjectif/objectif mais il est co-fabriqué par les composants de l’univers. Et cette composition est essentiel, parce que décrire les cellules qui me composent ne racontent pas qui je suis. Et c’est cette relation entre tous ces éléments, et ces idées qui ne sont pas tangibles, nous donnent un peu la capacité de décrire et d’être en interaction avec le monde autour de nous.
OP : Comment faire de la connaissance un objet d’émerveillement face à la complexité du monde et non une contrainte à apprendre, à acquérir à l’université ?
RM : Il est vrai qu’il y a pas mal de structures autour de nous qui tuent notre curiosité et qui rendent les gens passifs à partir d’une sorte de résignation, en disant : “bon, l’expert va s’en occuper… le chef d’état, le leader, etc…” Mais, je pense qu’il y a un élément clé, dans tout ça, qui va certainement bouleverser tout ça, c’est la question permanente et fondamentale pour tout humain — bien montrer dans un film comme Matrix — qui suis je ? Comment je fabrique mon idée de moi même ?
C’est impossible d’éviter, aujourd’hui, un certain doute. C’est vrai qu’on a des personnes qui sont tellement en grande douleur et tellement faible, d’une certaine manière, qu’elles ne sont pas capables de surmonter cette crainte existentielle, que ces personnes acceptent des réponses qui les amènent à se suicider avec une bombe.
Mais ce que ça veut dire, c’est pas que cette force de curiosité est éteinte, c’est précisément l’inverse : c’est qu’elle est si puissante mais si mal maîtrisée et si mal comprise qu’on en arrive à se nuire, que l’on parle de la société ou des personnes, des individus. Alors, pour moi aujourd’hui, la question, c’est pas pour critiquer, mais on ne peut pas développer un politique qui va recréer cette curiosité, parce qu’elle est bien là ! La question c’est l’inverse. C’est : “Est ce qu’on va savoir libérer ce besoin de s’exprimer, à travers une sorte de mise en commun de notre intelligence et de notre humilité ?” Et, je pense que là, on met en évidence des obstacles majeurs. C’est pas simplement que l’école étouffe l’idée qu’on a des connaissances nous-mêmes, parce qu’on est formé à attendre que le professeur nous explique la réponse. Mais, c’est qu’on s’est construit une idée de sécurité, de bien être, liée à la certitude. Et c’est une erreur grave, c’est une erreur presque fatale pour notre civilisation. D’ailleurs, ça peut l’être pour les humains comme espèce.
Il faut que l’on soit capable de revenir vers une forme d’humilité face au monde émergent, pas par résignation, comme aveu de notre incapacité à agir, mais simplement pour mettre notre libre arbitre dans un endroit où l’on sera à nouveau capable d’apprécier ce qui se passe sous nos yeux.
OP : Les sciences ont la fâcheuse tendance à devenir de plus en plus complexes, et cela à un rythme toujours plus soutenu. Quels moyens a la société, qui lui permettrait de continuer à intégrer ce que les sciences lui présentent, pour continuer à apprendre, à utiliser, toujours plus d’innovations, issues de ces recherches ?
RM : Pour être un tout petit peu provocateur, je dirais que je ne crois pas du tout en l’idée que le monde devient complexe. Il est complexe, point !
Qu’est-ce que c’est la complexité ? C’est pas compliqué ! Compliqué, c’est une machine avec des plusieurs pièces, c’est le jeu d’échec parce qu’il y a un nombre énorme de possibilités. Si bien que le jeu d’échec compliqué pas complexe, car c’est limité : les règles sont fixes, les ressources sont fixes, les buts sont fixes. C’est un système clos qui peut être compliqué ou plus simple. Mais il n’est pas complexe.
La complexité c’est une condition, ce n’est pas plus ou moins. On est dans un monde complexe ou on ne l’est pas. Le déterminisme est l’idée de l’univers clos, je pense la plupart des penseurs aujourd’hui pensent que c’est pas ça notre univers. Notre univers évolue avec créativité, dans le sens bergsonien. Et dans ce cas là, la question c’est : comment, nous on va apprécier, utiliser, se rendre compte de la richesse de chaque moment, pas seulement dans sa généralité, c’est à dire une optique très dominante des sociétés industrialisées, dans une optique d’échelle et de masse… comment apprécier l’éphémère, la spontanéité, la spécificité, toutes ces notions étant fondamentalement liées à l’expérience, aux processus, et finalement et d’une manière importante, à la science de la vie. Car, on vit notre vie en spécificité, pas en généralité, pas dans l’abstrait.
OP : Comment créer des passerelles entre la société civile et le monde de la recherche ?
RM : Je pense que le monde technique et scientifique qui est aujourd’hui héritier d’une époque d’ingénierie et d’industrialisation élitiste, est, comme on dit en anglais, un léopard qui ne peut pas changer ses spots, ses taches. Je pense que c’est un peu injuste de demander à une institution, une organisation qui a vécut et qui a soutenu une certaine approche, avec une certaine perspective, avec un certain pouvoir, de soudainement devenir quelque chose qui ne correspond pas à ses structures, à ses origines.
Donc, la question stratégique que je pose plus souvent c’est : “Est-ce que les institutions ont du pouvoir, le roi, peut céder le pouvoir d’une manière qui rende les transitions vers d’autres manières de gérer et d’organiser nos sociétés, avec moins de ruptures et violences profondes? C’est un peu une question à la Asimov, c’est un peu la question de Fondation où on demande si les révolutionnaires, ou les petites cabales, peuvent d’une manière ou d’une autre rendre les transitions plus faciles, moins dérangeantes, je n’y crois pas trop, mais ca veut pas dire qu’on ne devrait pas essayer.
OP : Quel est le rôle de la vulgarisation scientifique ?
RM : Je ne sais pas si je comprends bien le concept parce que je trouve que tout le monde fait de la recherche, si moi j’ai besoin de réparer un lave-linge, je vais faire un peu de recherche. Je vais voir si je peux le faire moi-même ou je vais voir si j’ai besoin d’un expert. Evidemment, ce que j’ai sur Youtube, c’est d’une manière de la vulgarisation car je ne suis pas formé comme technicien mais, en même temps, ça peut être suffisant pour réparer ce que j’ai à faire. La question de l’approfondissement des connaissances, la question de la superficialité et celle de l’imagination, parce que la vulgarisation c’est dramatiser l’objet observé d’une manière où tout le travail et l’accumulation des connaissances, derrière, par exemple la génétique ou l’informatique, est caché… Tout ça ce sont, pour moi, des enjeux d’ouverture et de transparence.
Fondamentalement, la question devient est-ce que l’angle, est-ce que les codes techniques vont être mit en open source, donc vont être accessibles à tous, ou est-ce qu’on va verrouiller ça dans un coffre fort pour que ça reste un pouvoir, parce que c’est rendu opaque. Dans cette dynamique de la relation entre nous, mais aussi avec nos outils, je pense qu’il y a des enjeux, des défis pour l’ouverture — dans cet esprit, Tim Berners-Lee a parler de l’internet sémiotique — tout ça ce sont des défis importants dans ce domaine. Pour l’instant, je trouve qu’on avance très peu dans cette direction. Je peux ajouter qu’il y a maintenant vingt ans, quand l’OCDE a organisé la première conférence autour de l’Internet, j’ai proposé, à cette époque, la création d’un système plus ouvert, d’un système de recherche où le partage des connaissances humaines ne sera pas seulement privé. Aujourd’hui, Google est le dépositaire des connaissances humaines. C’est formidable, c’est merveilleux mais c’est, je pense, en dessous du potentiel qu’Internet peut nous offrir.
OP : Qui, selon vous, seraient les meilleurs vecteurs de cette vulgarisation ?
RM : A la fin, c’est cette volonté intéressante de Wikipédia par exemple. Mais c’est aussi la blockchain : c’est l’idée d’une comptabilité ouverte, parce que une comptabilité ouverte dépend d’une entente, qui est une entente de sens, et une entente d’intentions. Alors, là, on établit des liens qui peuvent créer, pas une hiérarchie, mais un véritable nuage de changements, en permanence, des relations et de rapports.
À un moment je peux simplifier, je ne dis pas vulgariser, simplifier ou rendre quelque chose plus populaire dans le sens des masses, mais derrière ça, je n’ai pas la prétention de dire c’est supérieur ou pas, c’est une question d’utilité à un moment précis. Et si je suis comment dire, dans une déontologie en éthique d’ouverture — que tout doit être mit en évidence — on peut partager et vérifier, critiquer, repérer… je trouve qu’on change nos rapports de force qui sont des rapports dû à un système élitiste hiérarchique et industriel.
OP : A t’on le droit de convoquer l’imaginaire pour faire de la vulgarisation scientifique ?
RM : L’imagination est un des éléments clés, ou majeur, de notre manière d’aborder le monde, autour de nous, car on est en permanence en train d’imaginer que si je pousse sur un bouton quelque chose va se passer. Ça n’a pas eu lieu, mais, si je pousse, ça va se faire, alors on imagine et on agit. Alors, l’imagination joue un rôle énorme.
Mais, moi, j’espère que, et c’est mes souhaits à moi, que le manque de réponses adéquates des produits de masse, des choses qui sont compréhensibles par tout le monde, qui ne répondent pas à nos envies ou nos besoins d’intégrer ça dans notre propre façon de penser, ou de créer notre identité… j’espère que ca va diminuer, en fait.
Je vois la couche hollywoodienne, la couche, ce moyen de trouver quelque chose qui est parlant pour tout le monde. Cette couche reste évidemment importante, difficile à atteindre, parce que les goûts changent et qu’il faut être compréhensible tout en étant demandé par beaucoup de monde. Concevoir cette couche reste un défi impressionnant. Les stars réussissent une compétition farouche, c’est vraiment impressionnant, mais je trouve que cette couche qui reste superficielle et qui ne tient pas énormément à notre véritable expérience quotidienne, jour après jour, une expérience spécifique, dans notre communauté, devient un peu jetable, et n’est pas si importante.
OP : Il y a toujours une recherche plus ou moins longue entre une recherche et son application dans la société civile. Est-il alors pertinent d’essayer d’envisager les impacts d’innovation avant même leur arrivée dans la société de consommation et donc d’en faire une prospective ?
RM : L’imagination et les scénarios, ca veut dire inventer une histoire qui raconte quelque chose qui va se passer. Par exemple : par miracle, on va introduire miracle l’école universelle. C’est difficile à croire que c’est faisable vu que tous les enfants travaillent, que les parents ne savent pas lire et écrire, et surtout que comment les gens vont croire qu’un professeur venu de la ville peut enseigner dans notre village où on est vraiment pas du tout confiant en ces personnes bizarres de la ville.
Alors, l’école universelle, c’est pas faisable. On ne peut pas l’avoir. Mais, bon. On peut imaginer, au fur et à mesure : on va construire des écoles, former des enseignants et voir à partir des expériences, comment ça marche. On aura peut être pas la meilleure solution — là, on touche à l’idéal — mais, la deuxième ou troisième meilleure solution, qui a fait ses preuves à partir des expériences, va développer une sorte d’universalisme. Ça c’est une diffusion de quelque chose qui part d’une sorte d’imagination, de scénarios. On peut imaginer qu’on est tous amélioré par des puces, on peut imaginer qu’on vit sur d’autres planètes, on peut imaginer qu’on a une guerre de classe robot et humains. On a tout Ça dans le cinéma aujourd’hui…
OP : Sans être une discipline scientifique, la prospective est une tentative ouverte de modélisation de l’avenir, et les sciences fournissent la plupart des postulats indispensables à la construction d’une prospective. En quoi cette démarche peut être utile dans l’appropriation de la complexité grandissante du présent et la construction des sociétés de demain ?
RM : Je pense que c’est important, là ,de distinguer. Parce que le mot prospective, qu’on lui donne le sens de prédiction ou prévision ou modélisation… pour la plupart d’entre nous, tout ça appartient à une manière de penser qui est lié à la planification. Ça veut dire que c’est une approche pour coloniser demain. Moi, j’ai une idée de comment mes enfants devraient être et je vais imposer à mes enfants pour qu’ils vivent comme, moi, je pense qu’ils devraient vivre. Ça n’est pas très bien vu, une approche de la sorte. Mais on sait aussi que ca na marche pas. Qu’est ce que ca veut dire ?
Ça veut dire qu’il faut toujours essayer de mieux planifier, malgré le fait que c’est une manière de voir le monde qui ne correspond pas à la réalité et qui ne correspond pas à nos valeurs ?
Moi je dirais non ! il y a quelque chose qui ne va pas. La planification et la préparation sur les bases que nous on peut savoir ou imposer, ou d’une manière ou une autre, être clairvoyant ou prévoir d’une façon delphique ce qui va se passer, c’est vraiment une grave erreur dans notre manière de comprendre notre rapport avec la réalité. En termes de personnes capables d’agir mais aussi en termes de personnes capables de cerner le monde autour de nous.
Ce que je veux dire par ça, je pense que l’anticipation et la prospective en fait partie, devrait être diversifiée, notre approche et notre capacité d’utiliser le futur est en train de changer et pour moi devrait changer. Et en cas là, on va changer notre manière de poser les questions et on peut arriver à avoir un respect important pour la planification, avec toutes ces façons de fabriquer des fictions. Parce que les modèles et prévisions sont des fictions mais qui sont fabriquées d’une certaine manière, les modèles de Hollywood sont des fictions aussi, mais ils sont fabriqués d’une autre manière.
On peut diversifier et comprendre mieux notre manière de fabriquer nos idées du futur, qui sont toujours imaginaires et des fictions, mais aussi, pas seulement, ces futurs spécifiques — est-ce que c’est Terminator ou est-ce que c’est Matrix ou je ne sais pas quoi… On peut aussi poser la question : “A quoi sert le futur ?” Est-ce qu’il sert à enfermer ma réflexion, dans une idées de certitude que mon choix ou mes valeurs vont s’emparer et dominer demain. Comme je dis, c’est une approche colonisateur de demain.
Ou bien, je peux être plus humble, je pense plus ouvert, mais aussi plus dans une optique qui respecte nouveauté, émergence, complexité, qui est notre sort, dans notre univers, en utilisant le futur autrement. En disant le futur n’est pas quelque chose comme cible mais une manière de changer ma façon de regarder et comprendre le présent. Dans ce cas là le futur n’a rien à voir avec le futur, il est simplement une différente façon d’aborder le présent. Si on peut jouer sur ces deux optiques, planification et émergence, moi je considère qu’on sera capable de marcher sur deux jambes au lieu de sauter sur un seul.
Mais on peut aussi élargir notre espace ontologique. Et ça c’est, je dirais, une approche vers la résilience, donc sur la façon d’essayer d’assurer notre continuité, qui est peut-être plus porteur que l’ontologie qui est utilisée par la plupart aujourd’hui qui consiste à bétonner, planifier et chercher la certitude partout. Alors que l’on peut élargir l’incertitude et les possibilités par une construction ontologique inimaginable, à travers notre imagination, et notre créativité, on est en train de diversifier notre monde et on peut imaginer une approche de diversification vers le risque au lieu de l’assurance. Et là on touche vraiment à deux champs et deux mentalités différentes.
Je dis pas que c’est l’un ou l’autre. Je dis qu’on est incroyablement biaisés, pour un tas de raisons, sur l’approche déterministe, défensive, de continuité, prévision et prédiction et que ça étouffe notre imagination en fait, que ca diminue notre univers.
OP : La prospective est à envisagée comme une expérience de pensée, une spéculation parfois transgressive, souvent génératrice de ruptures, d’ailleurs certains rapprochent la prospective des sciences humaines. A-t-on le droit d’appliquer la prospective à la recherche scientifique, l’avenir de cette recherche comme celui de la consommation, est-il lié à des innovations ? A des technologies de rupture ?
RM : On vit une période très défensive. Je vais répondre de manière assez spécifique. On voit, par exemple, qu’on essaye consolide les universités, on essaie de focaliser la recherche sur les grands défis, on essaye de canaliser pour des raisons de dépenses et des raisons de budgets, d’autérité, mais aussi parce qu’on a des urgences comme le réchauffement climatique etc. et je trouve que là, c’est vrai qu’il y a peut-être des grands saut qui vont se faire. Mais, je pense que si on regarde l’histoire des découvertes et de notre manière de mieux comprendre ce qu’il se passe autour de nous, ca ne se fait pas comme ca. C’est qu’il y a énormément de sérendipité et des erreurs. Avec cet acharnement qui réduit, par exemple, les études de grec ou je n’en sais rien, ou de l’histoire de l’archéologie, l’anthropologie… ces approches qui sont d’une certaine manière efficaces et planifiées pour un meilleur futur, courent le risque de, en fait, passer à côté de toutes les expériences qui ne sont pas menées ou inventées, ou volontairement conçues par les humains, mais qui sont en train de se passer autour de nous en permanence. C’est à dire qu’on vit dans une richesse d’expérience inouïe, mais si on est focalisé sur les grandes solutions du grand problème qu’on a définit d’avance mais qui ne correspond pas à ce qui va se passer, on est en train de fabriquer des pauvretés dans un contexte où on a une énorme richesse, et aujourd’hui ces forcings scientifiques ou ces forcings politiques sont plutôt une réflexion du déclin du système industriel, ou de masse, et aussi la panique de ceux qui sont au pouvoir qui cherchent à rester au pouvoir.
Alors, moi, je ne partage pas cette approche et je pense que laisser les petites fleurs pousser, là où elles sont, avec des petites universités, des petits centres de recherche, des petits chercheurs partout, ce qu’on appelle amateurs mais qui pour moi ne le sont pas : tout amateur peut devenir professionnel, et un professionnel simplement dans un domaine très étroit peut être amateur dans d’autres domaines, et c’est peut être ces domaines où il est amateur qui vont être porteurs pour là où il est professionnel : on le voit tout le temps dans le contexte des découvertes des sauts de nos connaissances.
Alors si on essaye de faire de la réflexion et de l’invention quelque chose mécanique, dans ce cas là on est vraiment perdu.
OP : Auriez vous une prospective à partager avec nous ?
RM : Je l’ai déjà évoqué… c’est un terme qui est un peu à la marge linguistique, c’est l’idée de littératie du futur, en anglais on appelle ça future literacy.
Pour moi, il y a là quelque chose qui est en train d’émerger, je ne sais pas ce que ca va devenir. Mais je vois une certaines fécondités d’idées autour de cette notion, qu’il n’y a pas qu’un seul futur, dans le sens pas de futur imaginé mais dans le sens qu’est ce que c’est le futur.
Si on imagine un futur qui n’est pas à propos du futur mais à propos du présent, c’est à dire qu’on est dans l’anticipation qui est plus diversifié, on devient bien plus capables d’utiliser le futur, malgré le fait que le futur n’existe pas. Ça veut dire qu’on on devient mieux, on est plus habile avec des systèmes d’anticipation. Et là, dedans je souligne simplement, je pense le constat la proposition, l’hypothèse qui est assez porteur, c’est qu’une partie de la définition de la vie c’est l’anticipation. Alors, même un arbre ou même un protozoaire, une petite bête a des systèmes d’anticipation. Ces systèmes d’anticipation ne sont pas conscients. Mais ça démontre bien que l’anticipation c’est à dire donc la manière d’amener le futur dans le présent, est quelque chose qui est partout.
Alors j’espère qu’on peut commencer à plus approfondir nos connaissances sur ce sujet et développer nos compétences générales, parce que la littératie c’est une compétence, c’est capacité, et vu le défi de la liberté et je reviens sur la question de l’identité, face à cette douleur de fabriquer nos identités au delà des certitudes imposées qui ne sont plus porteur, qui ne répondent pas à nos envies et nos besoins, comment on va être capable de créer cette identité. Je pense qu’un élément clé va être notre capacité d’utiliser le futur, c’est à dire la littératie du futur et j’espère qu’on est en train de le créer.


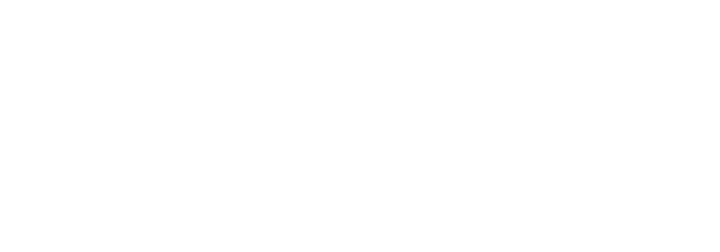
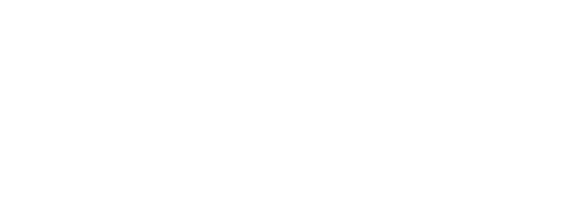

 Ecko Magazine
Ecko Magazine